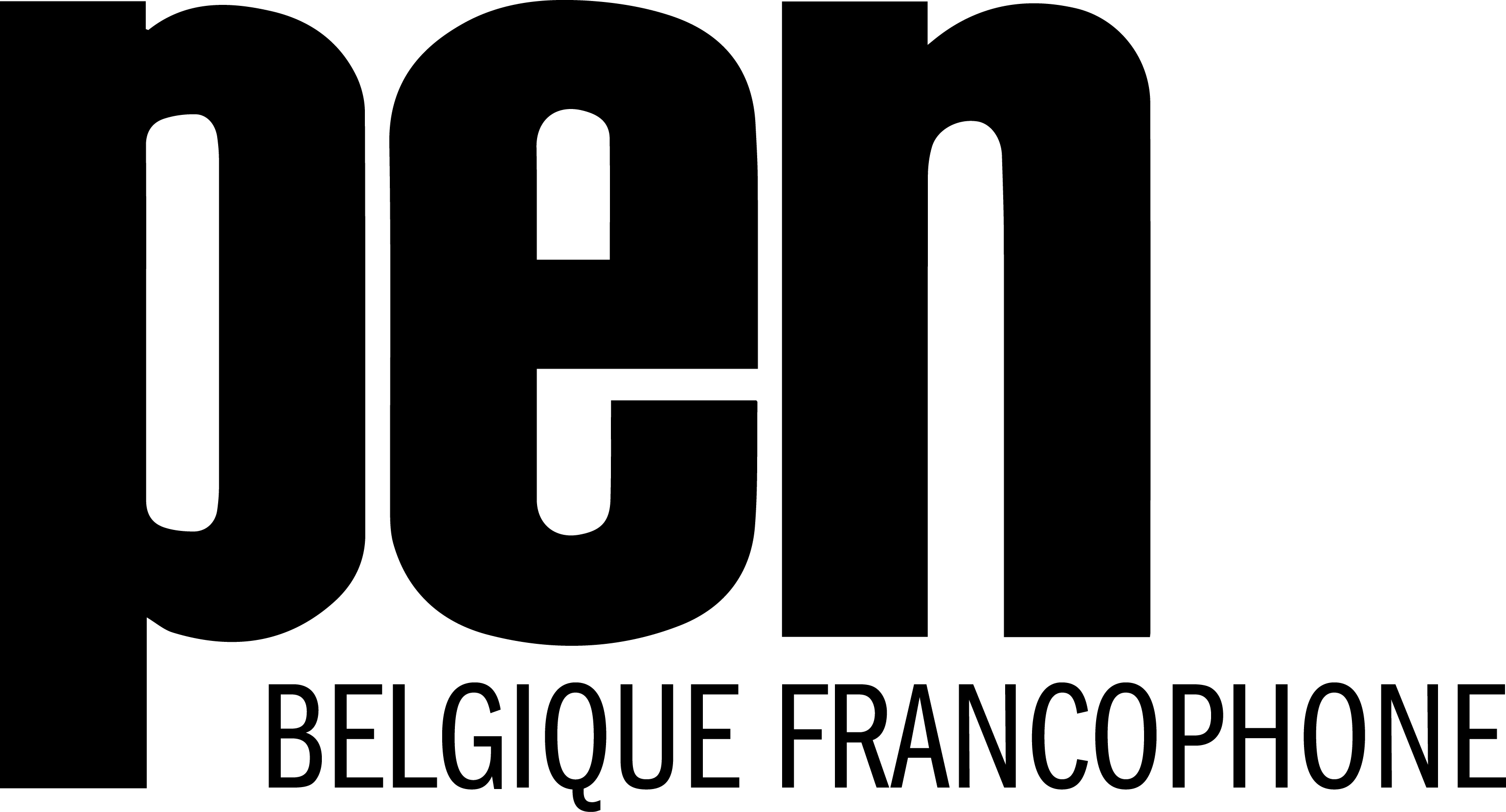Seyhmus Dagtekin: faire résonner le souffle qui unit l’humanité

Le 19 mars 2025, Seyhmus Dagtekin, poète kurde de langue française, était l’invité de Pen Belgique francophone dans le cadre du cycle de conférences « Voix de l’exil et des minorités ». Répondant aux questions d’Alain Lallemand, il a retracé avec nous le parcours qui l’a mené de son village natal de Harun, dans le Kurdistan turc, jusqu’en France et qui a permis sa naissance à la langue française, placée au centre de son écriture poétique. Il n’a pas manqué de souligner les grands principes esthétiques et éthiques qui guident son écriture, habitée par la transmission du souffle, la quête de l’humanité et le souci de maintenir une place commune malgré les différences. Humaniste convaincu, il n’a pas caché son inquiétude face à la situation actuelle des Kurdes, de la Turquie et des États-Unis. Mais il a aussi réaffirmé l’espoir d’une solidarité capable de transcender les structures politiques actuelles, bien moins éternelles que le souffle humain toujours repris depuis les origines.
---------------------------------------------
Seyhmus Dagtekin, poète et romancier kurde né dans les années 1960-1965 (la date précise est incertaine), évoque tout d’abord ses origines dans un petit village reculé du Sud-Est de la Turquie, en zone kurde, près d’Adiyaman. Il en décrit la rudesse et l’isolement : il n’y avait pas de roue (tous les déplacements et transports se faisaient à dos d’âne ou de cheval), aucune école au départ, pas de mosquée non plus. Les familles y parlaient un kurde strictement oral, et l’écriture n’y entrait que par le biais d’emballages de contrebande (papiers à cigarettes, étiquettes en arabe, etc.). Il souligne à quel point cette enfance, marquée par l’absence de l’État turc et par les kamas (tribus) kurdes de montagne, l’a imprégné d’une vision du monde où prime l’oralité, le chant spontané et la fusion avec la nature environnante.
Il aborde ensuite son parcours scolaire : un premier instituteur arrive au village alors qu’il a cinq ou six ans. L’enfant, qui ne connaît que le kurde, apprend alors le turc, sans en éprouver de véritable traumatisme. Conscient toutefois que pour beaucoup d’autres Kurdes, le passage de la langue maternelle kurde à la langue institutionnelle turque a pu être douloureux, il affirme n’avoir pour sa part rencontré aucune difficulté : il apprend vite, avec curiosité, et passe aux études secondaires à Adiyaman. C’est là qu’il découvre la modernité (électricité, télévision, cinéma). En parallèle, un contexte de rupture familiale s’amorce : son frère aîné part travailler en France et, plus tard, Sehmus lui-même se rend à Nancy, en 1987, pour la rejoindre, sur la demande de leur père.
En France, à un peu plus de vingt ans, il s’immerge dans la langue française. Il raconte la manière dont il a « plongé » dans ce qu’il appelle un « bain linguistique », en s’appuyant au début sur un dictionnaire Petit Larousse illustré, ainsi que sur son premier livre acheté d’occasion : Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Rapidement, il s’éprend de la poésie française et lit également d’autres grands auteurs (Maupassant, Hugo, Balzac). Il a auparavant étudié le journalisme à Ankara, puis il entreprend des études de cinéma à Paris. Pourtant, il ne deviendra ni journaliste ni cinéaste, car la poésie l’occupe avant tout : il s’y consacre pieds et poings, tout en forgeant une écriture nourrie de toutes les cultures qu’il traverse (turque, kurde, française).
Au fil de l’échange avec Alain Lallemand, Seyhmus Dagtekin insiste sur l’idée que la poésie est fondée sur un souffle premier, antérieur aux mots et aux langues. Il évoque le fait d’avoir chantonné seul dans la montagne, en gardant les chèvres, comme beaucoup de bergers kurdes. Il retrouve dans la syllabe prolongée et les chants ancestraux l’amorce universelle de la poésie, ce qui lui permet de naviguer avec aisance entre le kurde, le turc et désormais le français. Il cite volontiers Rûmî, Farîd-ud-dîn ‘Attâr (auteur de la Conférence des oiseaux), ainsi que des œuvres fondatrices comme le Mahabharata. Il y perçoit la présence d’une « syllabe » ou d’un « cri » initial que les langues, les alphabets et les traditions culturelles ne font que déployer. Dagtekin aime aussi rapprocher le chant kurde oral de cet « appel au monde » – un appel présent dans la tradition soufie et dans les grandes épopées antiques.
Le journaliste l’interroge sur la part d’influence de la littérature turque et de la littérature française dans son écriture. Dagtekin s‘est nourri de lectures en turc (fascination pour Dostoïevski, découvert en traduction turque) tout autant que de nombreuses découvertes en français (Baudelaire, Rimbaud…). Il se définit toutefois moins comme un écrivain « kurde » ou « turc » qu‘un être humain en déplacement constant, porté par l’universalité de la poésie. Il raconte s’être senti « naître » au français, dans un émerveillement proche de celui des enfants lorsqu’ils entrent pour la première fois dans le langage.
En parallèle, Dagtekin revient sur la situation politique des Kurdes dans divers pays de la région (Turquie, Syrie, Iran, Irak). Il fustige l’absence d’un véritable espace démocratique où Kurdes et non-Kurdes pourraient enfin reconnaître leurs droits et vivre l’égalité. À ses yeux, le conflit n’a jamais pu se résoudre par discussion ou par respect mutuel : les Kurdes restent une minorité sans cesse niée, distante de tout pouvoir central. Il mentionne Abdullah Öcalan, la question du PKK, la répression exercée par le régime turc, tout en soulignant que la paix ne pourra advenir tant qu’une structure politique réellement inclusive et démocratique n’émergera pas. Par ailleurs, il critique fortement la tendance des dirigeants (en Turquie, en Syrie, etc.) à s’accaparer le pouvoir, quitte à piétiner toute égalité.
La soirée animée par Alain Lallemand dans le cadre de P.E.N. Belgique se conclut par des questions du public, souvent émues, portant sur l’exil, l’identité, la nostalgie et la quête de racines : plusieurs personnes présentes partagent leurs histoires familiales (origines migratoires, perte ou transmission de la langue…). Dagtekin esquisse l’idée qu’il faut dépasser le seul « paradis perdu » et se tourner vers la construction d’un plus grand espace commun, pour perpétuer l’humanité. Selon lui, seuls l’échange, le vocabulaire partagé et la reconnaissance de l’autre permettent la coexistence et l’épanouissement culturel. La rencontre se termine sur la lecture de quelques-uns de ses poèmes et extraits de ses livres (comme À la Source, La Nuit, ou Élegie pour ma mère), en français et en kurde, illustrant poétiquement ce souffle primordial qui relie les êtres au-delà des frontières linguistiques et politiques.